Les gens sympathiques écrivent parfois des livres.
« T’as vu Machin chez Trapenard ? Qu’est-ce qu’il est sympa ! Tu l’as pas trouvé sympa ? Je vais acheter son livre, il est trop sympa. »
Quand mes amis m’annoncent ce genre de chose, je demande, un peu plus tard : « Il est bien le livre de Machin ? ». « Bof, pas génial ».
Ça n’aurait aucune importance si cette déception ne finissait par englober l’activité même de lire et toute cette affaire appelée littérature. Le découragement : dommage collatéral des mauvais livres. Remède : admettre une bonne fois pour toutes que littérature et sympathie n’ont pas le moindre rapport, et que quand cela arrive, c’est fortuit.
Raphaël Quenard est un comédien « sympathique ».
Sa dégaine de pedzouille qui s’en amuse lui a offert des rôles atypiques dans des productions originales (ou vice-versa). Chez Quentin Dupieux, il a merveilleusement incarné Yannick dont l’entêtement naïf amuse, puis émeut et enfin terrorise. Quenard s’est aussi rendu célèbre pour son attitude en interview : sa pointe d’accent isérois, ses tournures ampoulées, sa fausse naïveté, ses hommages aux paysans de sa région. Un côté « je-garde-un-pied-dans-le-réel » qui a séduit.
Ensuite, on s’est habitués. A sa dégaine, à ses tournures.
Voulait-il montrer qu’il n’était pas qu’un singe aux tours habiles mais un type qui a des choses à dire ?
Il a écrit un roman.
C’est l’épopée d’un looser déprimé qui devient serial-killer. Par désoeuvrement, vengeance, dépit, crétinisme ? « Toute ma vie j’ai eu honte. D’abord de ne pas trouver un sens à mon existence. Ensuite de ne pas trouver de raison valable à ce non-sens, fatigué à l’idée même d’essayer. » Si le mobile est flottant, le projet est précis : parmi des millions d’histoires possibles, Quenard a voulu que le narrateur zigouille des femmes en série mais attention, pas au hasard : une femme de chaque catégorie sociale, en partant des aristos et jusqu’aux sdf.
Bon ! Un truc à la Belvaux/Poelvoorde, mâtiné d’étude socio-politique ?
Pourquoi pas.
Les chapitres énumèrent lesdites catégories sociales comme autant de marches à descendre :
« L’aristocrate » – « L’ingénieure » – « La jeune active » – « La femme de footballeur » – « La caissière » – « La sdf ».
On notera que les catégories ne sont pas strictement socio-professionnelles, « femme de footballeur » n’étant pas un métier mais plutôt un néo-statut, révélateur d’évolutions sociales.
Je le souligne aussitôt pour la suite.
Entrons donc dans la France révélée par Monsieur Quenard. Oubliez Bourdieu et Levi-Strauss, Christophe Guilluy et Jérôme Fourquet ! Quenard sait exactement de quoi est fait notre monde, il vient d’Echirolles, banlieue moche de Grenoble (je me permets, hein, il se trouve que je connais bien le coin), et les ors de Cannes ne lui ont pas fait oublier quoi que ce soit. Il a traversé les classes sociales et les a regardées bien en face : foin de la langue de bois, il dira tout !
Las. « Il faut toujours dire ce qu’on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit. ». Tout le monde n’est pas Charles Péguy.
La première victime est donc « l’aristocrate », Marthe, qui vit dans le 16ème parisien, dans un somptueux appartement « au 7ème étage ». Ça commence mal : les immeubles haussmanniens ne comptent que 6 étages, au-dessus ce sont les chambres de bonne, sous les toits. On doute qu’il s’agisse d’un immeuble moderne, d’autant que la suite confirme l’ancien : « somptueux escaliers », « marches sur plus de deux mètres de large », « tapis rouge », «encoignures ornées de baguette dorée », « moulures en tout genre », « le parquet scintille de mille feux. Le plafond est inatteignable ».
Mais voilà l’observation qui tue : « les espaces sont farcis de statues grecques marmoréennes qui semblent tout droit sorties d’un musée. Elles représentent je ne sais quels personnages. Certainement d’illustres olibrius. »
Allons bon. Quenard a du voir ça à Dubaï, et aura confondu. Ne pas savoir distinguer aristocrates, bourgeois et DJ rastaquouères, c’est fâcheux quand on prétend restituer une réalité sociologique. Le détail est le Tout, mais bon, puisqu’on me dit que Quenard est « sympa »…
Marthe est poignardée dans la nuque.
« L’ingénieure » est supposée représenter la classe bourgeoise. Nous voici dans le 13ème le plus ancien, pierre et brique, loin du béton du quartier chinois. On le sait car le nom de la rue est précisé, et elle existe bien. On découvre une famille composée d’Hélène, ingénieure, la mère, de Franck, oncologue à Necker, le père, de leur fille lycéenne (à qui le narrateur se débrouille pour donner des cours particuliers), et de la jeune fille au pair américaine. Hélène est écolo « zéro déchets », mange bio et sans gluten, même si son mari lui explique qu’elle se fait avoir par les lobbys qui jouent sur ses peurs pour lui vendre des produits bidons.
(On est un gars lucide sur les circuits économiques et les rapports de force, pas croire, le show-bizz ne nous a pas lavé la cervelle !)
L’analyse est recevable, mais on se demande qui parle. Quenard est si impatient de nous dire tout ce qu’il a pigé du monde, qu’il en coupe la parole à son personnage.
Bref : Hélène est empoisonnée au cyanure.
« La femme de footballeur » se prénomme Cindy : c’est une fille « de milieu modeste » qui a grandi à Villeneuve-Loubet, en banlieue d’Antibes.
(On est un gars qui maîtrise sa géographie sociale, on sait faire la différence entre une ville et sa banlieue !)
Après son BTS Tourisme, Cindy était en stage dans un hôtel de Megève quand elle y a croisé le footballeur star Nestor Gonzague. Désormais sa fiancée, elle vit dans un luxe et une oisiveté qui la déstabilisent et même l’oppressent, car « elle n’est pas si bête que ça », Cindy.
(On est une caricature de bourrin mais on sait observer les femmes, hin hin…)
Notre assassin approche des joueurs du PSG : Nestor Gonzague, Hubert Léopold et Jean Gassien. Nous ne sommes pas dans un monde absolument imaginaire puisque le héros aperçoit dans les loges VIP « Sizolas Narkocy, Dabel Jemmouz, Kaller As Nhelaifi » (pour Nasser El Khelaifi, le vrai président du club, un Qatari).
Même si on ne s’intéresse pas au foot, on sait au moins que c’est le temple du multiracialisme. Le PSG est composé de joueurs d’origines et de couleur de peau diverses : il ne s’agit ni de s’en réjouir ni de le déplorer, c’est comme le métier exercé par les bourgeois ou les parquets brillants des aristos : un fait.
Mais, c’est bizarre, Quenard n’entre jamais dans ce genre de précision. Pas un mot sur le physique des joueurs, leurs coiffures, leurs tatouages. Même les prénoms fictifs évitent de ressembler aux Ousmane, Ilyes ou Nordi, ou encore Carlos ou Renato des vrais équipiers.
Tout juste ce Nestor possiblement exotique, rien de plus.
Citer Villeneuve-Loubet ou Megève, précisions monstrueusement connotées, d’accord. Mais préciser une couleur de peau ou un prénom africain, pas d’accord.
Ah bon.
Etrange d’invisibiliser ainsi certaines caractéristiques. Pourquoi alors préciser que les fêtes organisées chez Nestor provoquent un embouteillage de «Bentley, Lamborghini, Porsche et Ferrari » sur le « long tapis de gravillons serti d’un gazon soigné », pour décrire le luxe tape-à-l’œil de ces nouveaux riches, ou que le narrateur discute longuement de religion avec Jean Gassien, croyant fervent, ce qui donne un indice sur un état d’esprit ?
Pourquoi ne pas préciser quelle est la religion en question, ni donner d’indication sur les visages et les allures ?
Cindy est défenestrée du troisième étage.
Les débuts de chapitre donnent lieu à des digressions sur les tarifs comparés d’un MacDo et d’une pipe par les putes de Chambéry, sur les pratiques masturbatoires ou la carrière de kleptomane du narrateur. Ou encore sur les joints et leurs vertus laxatives (trois pages). « Au départ, pour moi, l’excuse c’est l’envie de chier. Pour déféquer le matin, rien de tel que de fumer. La matin, clope ou tarpé, tu pars couler. » (Je m’en tiens là).
Quelques considérations sur la vieillesse : une femme âgée « dégouline de rides », sa vessie « n’a plus sa résistance de jadis », et sa culotte est « une benne à ordures laissée à l’abandon ». Oui, Quenard confond décrire un truc répugnant et écrire de façon répugnante. Il confond liberté de ton et caca sur la moquette. Si seulement c’était vraiment grossier, drôlement obscène, façon La Furia ou San Antonio… !
« La jeune active » est approchée dans un atelier de cuisine destiné à favoriser les rencontres. On découvre Louise, une rousse plantureuse.
« Elle doit flirter avec le quintal mais le faciès est plutôt suggestif. Elle a eu la main lourde sur le rouge à lèvres. Le dépôt déborde de ses lèvres par endroits. Mon esprit déréglé interprète la maladresse comme une volonté de se donner l’air souillonne de celle qui vient de se faire limer la barquette. Je me vois déjà déverser mon sperme chaud sur ses bonnes joues. Louise est ce qu’on appelle un BBW, Big Beautiful Women. Je me suis toujours masturbé sur des profils de son genre. Je laisse les bons produits aux exigeants, et je me contente du rebut. De toute façon, elle va finir en pièce comme du poulet d’élevage alors autant prendre la plus grasse. »
On hurlera à la grossophobie, moi pas. Je suis pour dire qu’une femme est grosse si elle l’est, le problème est que ça aurait pu être tellement mieux dit.
Louise se félicite de gagner 1.600 euros nets peu après avoir obtenu son IUT, mais se sent délaissée par son militaire de mari qui gagne 1.900 euros nets…
(On est un auteur du réel, je vous dis, on connaît les vrais salaires par CSP, on a potassé le sujet !)
Louise est poussée d’une falaise dans le massif de Chartreuse, où elle est venue, ni une ni deux, passer un week-end avec le narrateur qu’elle connaît à peine.
Il nous reste « la caissière », ce sera celle d’un supermarché de la rue de Tolbiac. « Une jeune femme brune toute frêle. Frêle pour ne pas dire rachitique. Son visage prouve à lui seul combien l’existence humaine peut être dure. Ses yeux sont soucieux et ses joues creusées par une alarmante maigreur. » Le prolétariat produit davantage d’obésité que de maigreur, mais admettons. A peine quatre pages pour balancer qu’elle se prénomme Jessica, s’occupe d’un pénible petit frère prénommé Dewi (j’ai vérifié : c’est hébreu), et habite assez près pour rentrer chez elle pendant son heure de pause (peu probable pour une smicarde mais on n’allait tout de même pas réellement nous décrire la banlieue, ça obligerait à préciser des trucs compliqués à dire).
La voilà déjà baignant dans son sang, carotide tranchée.
Finissons-en enfin avec « la sdf », Shakira la junkie, rencontrée sur un banc parisien. Le narrateur l’entraîne dans une caravane abandonnée en lisière de champ à Rennemoulin, bourgade du fin fond des Yvelines, à l’orée de la forêt de Marly. Quenard esquive encore : la seule fois où l’action se situe en banlieue, elle est choisie dans un secteur à peu près paisible et champêtre, une des exceptions de l’ile de France. Dans la caravane, le narrateur attache Shakira « par le cou au cadre du lit », « la frappe gaillardement jusqu’à ce qu’elle perde connaissance », puis la laisse crever dans son « bain d’excréments et d’immenses taches d’urine séchée », ce qui prendra trois jours.
Cette litanie lourdingue de femmes atrocement trucidées est complétée du meurtre imprévu de Franky, un type qui poursuit le narrateur pour quêter un peu de conversation. Ce Franky débite des banalités assommantes dont il est très fier, parfaitement inconscient d’être importun… (ça nous rappelle quelqu’un mais qui ? Ah si : Quenard lui-même).
Il terminera tué à coups de poings.
Tout sonne pathétiquement faux, mais ce n’est pas le plus grave. La mise en garde en début de texte : « la discutable dextérité dont j’ai fait montre pour me dépatouiller de mon existence laisse à penser que je suis tout sauf un exemple à suivre » est hors sujet. Il aurait plutôt fallu prévenir que cette exploration prétendument sociale serait borgne, amputée d’un bon morceau de réel.
Car si je lève les yeux de mon livre, que je sois à Paris (où l’action se passe essentiellement), ou en région parisienne, dans le métro, le RER ou le bus, dans la rue ou un commerce, je vois peu de physiques d’aristocrates, quelques rousses grassouillettes et caissières malingres, mais beaucoup, beaucoup de visages dont l’origine est indubitablement extra-européenne : Afrique, Maghreb, Moyen-Orient, Turquie, Asie, et quelques autres.
Une couleur de peau, une tenue de tradition étrangère, un accent, une coiffure, une langue, des pratiques culturelles ou cultuelles : ce ne sont que des caractéristiques qu’il s’agit non pas de juger mais de simplement relever, au même titre que la rousseur d’une femme, les rides d’une vieillarde, les cernes d’une caissière ou « le visage grêlé » de varicelle d’une clocharde.
Le professeur Quenard a divisé l’humanité en six catégories sociales, et en donne des illustrations qui ignorent soigneusement un 1/5ème de la population, plus encore en région parisienne. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est l’INSEE :
7,2 millions d’immigrés et 5,6 millions d’étrangers vivent en France, selon les données du recensement 2023. Les premiers représentent 10,7 % de la population, les seconds 8,2 %. Total : 18,9 %. S’y trouvent ceux entrés irrégulièrement et régularisés ensuite (400.000 depuis 2012), les titres de séjour en cours, les demandeurs d’asile etc. Il faut ajouter les personnes en situation irrégulière : récemment, monsieur Darmanin a évoqué le chiffre de 600 000 à 800 000, soit 0,89 à 1,19% de la population totale.
Le total monte à 20 %.
Une personne sur cinq sur le sol français est donc d’origine étrangère, sans compter les personnes nées d’un étranger et d’un(e) Français(e). On monte alors à une personne sur quatre au bas mot. Parmi ces personnes, l’essentiel vient d’outre-Europe.
La répartition de ces personnes sur le territoire français est inégale et c’est précisément l’ile de France qui concentre le plus de ces 20 %. Si vous n’aimez pas Darmanin, va pour Karim Zéribi, ex-député européen, Parti des Ecologistes, qui affirme au nom des seuls Algériens : « nous sommes 5 millions, la communauté algérienne pèse 10% sur l’élection présidentielle. »
Il se vante certainement un peu, mais une chose est sûre : Algériens et autres origines, ça fait du monde. Des tas de gens impossibles à gommer du réel qu’on prétend observer, des tas de gens avec d’autres dégaines, qui exercent d’autres métiers qu’ingénieur ou caissière, qui vivent dans une de nos nombreuses et vastes banlieues dans des appartements qui méritent autant d’être décrits que ceux de la bourgeoisie.
Délicat ? Risqué ? Ah tiens. Bizarre. L’audace de Quenard se limiterait donc à moquer des physiques de femmes blanches, trop grosses ou trop maigres, et décrire des assassinats violents ?
Sur France Inter, une Sonia Devillers frétillante déplore gentiment les vilains féminicides racontés par Quenard. Elle lui rappelle que les « féministes » de Libé ou Arrêts sur image ont étrillé le bouquin, voire refusé de le lire. Il réplique :
« La moralité n’a pas sa place dans l’art, parce que si on commence à ne décrire que des personnages sans failles, sans obscurité, sans zone d’ombre, on risque de s’ennuyer. »
Je ne lui fais pas dire ! Que n’a-t-il suivi ce principe jusqu’au bout !
Puis il explique, tout faraud : les crimes ne composent pas l’essentiel du livre, ce qu’il propose surtout c’est « un récit de voyage entre les classes sociales ».
Il insiste, le bougre !
Sa sociologie est bancale et borgne, mais cela ne lui sera jamais reproché par les critiques, eux-mêmes complètement aveugles.
Beigbeder, dans le Figaro, lui passe une soufflante, tel un prof consterné par un élève dont il attendait mieux. Navré, il reproche à Quenard ses «calembours lourds » et ses nombreux clichés, mais ne dit mot de l’éléphant qui se promène de page en page.
Le Masque et la plume se montre également très réservé : le bouquin est jugé mauvais, et puis c’est quand même un récit de féminicides, c’est mal.
Pas un mot sur le strabisme intellectuel de Quenard, sa banale prudence politique incompatible avec l’étude sociologique annoncée urbi et orbi. Chacun a bien intégré la convention actuelle relative à la population immigrée du pays : on se la boucle, on n’a rien vu.
Comme dit son minable personnage :
« Parce que moi, je n’ai jamais su qui être ni quoi en penser. Avoir des convictions est une énigme pour moi. Je suis tout et son contraire, avant tout celui que j’ai besoin d’être. »
En effet.
A part ça, si vous voulez entendre de vraies voix masculines tortueuses parler des femmes, lisez plutôt Septentrion de Calaferte, ou n’importe quel Bukowski, ou Céline. Des mecs pas forcément sympas, mais de vrais écrivains, avec des yeux en état de marche.
Ouvrages cités :
Clamser à Tataouine, Raphaël Quenard (Flammarion), 2025
Septentrion, Louis Calaferte (Livre de poche Folio), 1963 pour la première édition
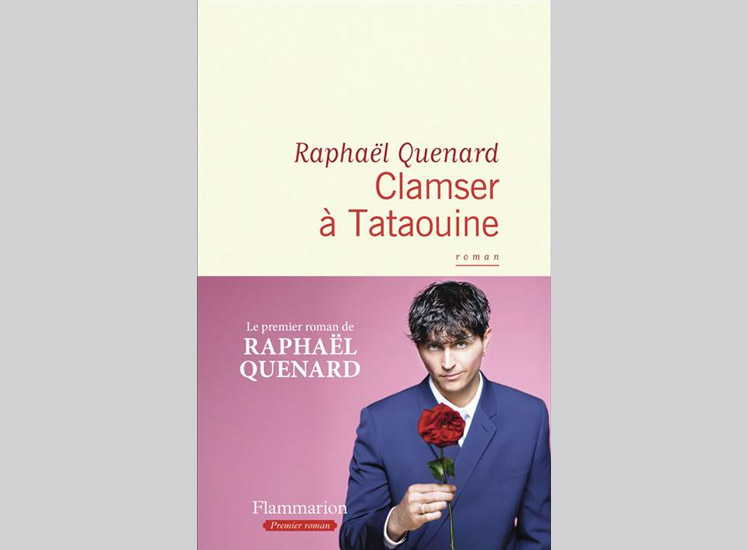
Laisser un commentaire